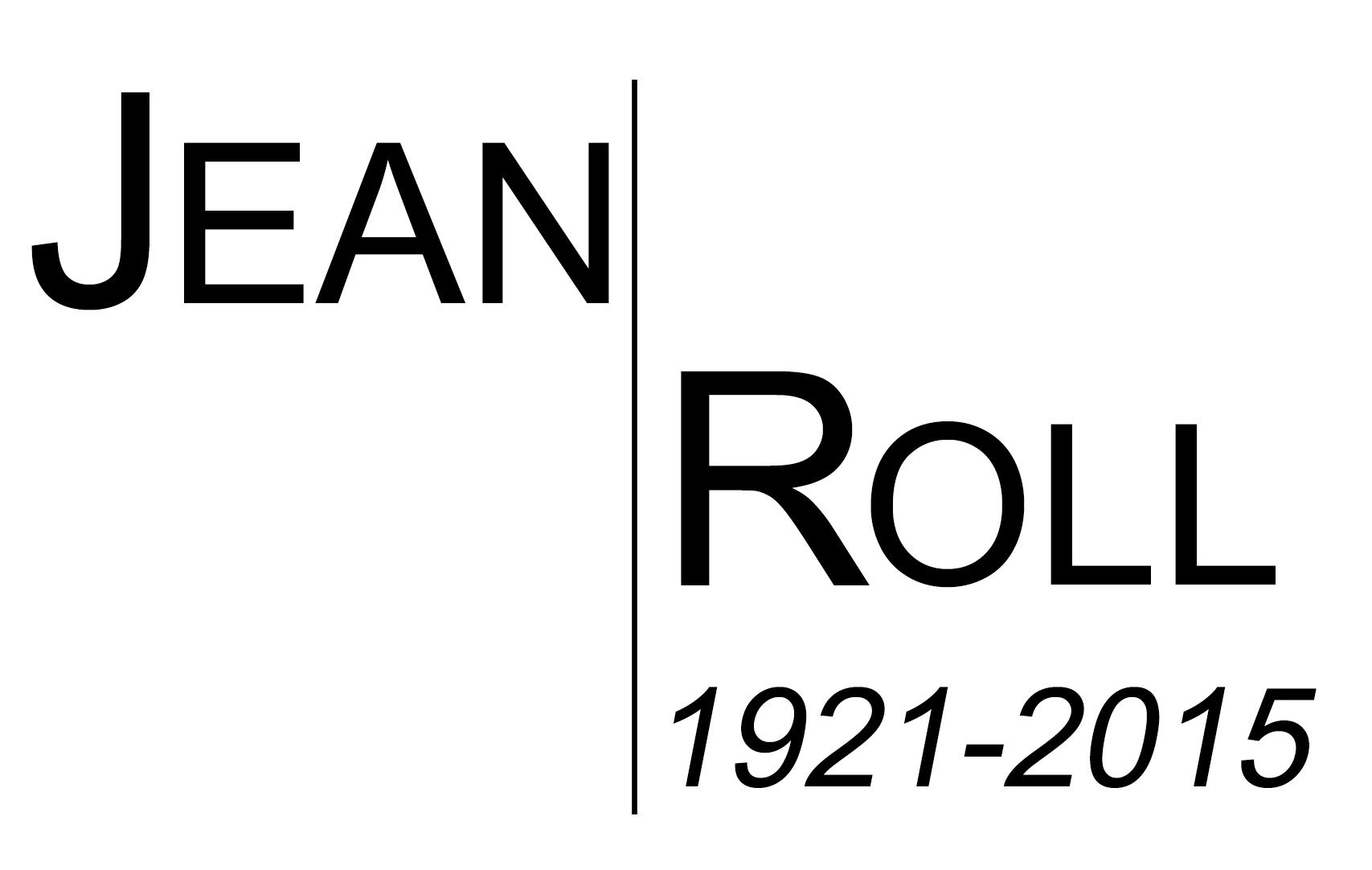Biographie par l'artiste
JEAN ROLL 1921 – 2015
artiste-peintre genevois
Biographie écrite par l'artiste
Je suis quasiment né dans les coulisses du théâtre de la Comédie de Genève. C’est là du moins que je me suis éveillé consciemment au monde qui m’entourait. Et ce monde était obscur, lunaire, magique.
Cependant, mes impressions remontent bien au-delà de cet éveil; elles ont dû commencer avant ma naissance car ma mère était comédienne et danseuse dans la troupe de Georges et Ludmilla Pitoëff. Elle a même été vaguement pianiste dans un cinéma muet. Tout cela n’a pas été sans conséquences.
M’est-il resté de cette époque le goût du rythme, de la musique et des incessants recommencements avec l’espoir d’obtenir un jour la perfection ou du moins d’approcher de l’idée que je m’en fais? Qui sait?
De mon père il n’a jamais été beaucoup question, mais ce qui est certain, c’est qu’il était aussi homme de théâtre. Il ne m’a rien laissé, même pas son nom. Cela m’importait peu d’ailleurs, car j’étais là, j’étais bien et de nombreuses marraines m’entouraient comme des fées. Très gentilles, un peu redoutables toutefois sous leur maquillage et leur parfum violent. Lorsque je passais des bras de l’une aux bras de l’autre je me perdais délicieusement dans des opulences moites. Par contre, je me griffais les joues à leurs costumes chamarrés d’or et à leurs monstrueux bijoux. Elles m’ont toutefois jeté de bons sorts.
La pénombre pleine de chuchotements rendait ces lieux très mystérieux. Ils étaient comme les antichambres du paradis. Car le paradis était juste à côté derrière ces grands murs de papier couverts d’inscription de toutes les couleurs. J’en entrevoyais parfois quelques fulgurances et il m’en arrivait des musiques divines, des cris, des tonnerres et la voix des anges.
De temps à autre, quelques-uns de ces anges, dont les transparentes ailes étaient curieusement placées autour de la taille, sortaient du saint des saints en virevoltant et y retournaient de même. Et voilà que ma mère était un de ces anges. Elle m’embrassait en passant et retournait participer à des gloires qui, de loin déjà, me faisaient défaillir de plaisir.
J’avais aussi des parrains, souvent des couples de parrains, très nobles et d’une exquise tendresse. À eux aussi je dois beaucoup ; ils m’ont détourné pour toujours de la brutalité et de la vulgarité.
Mais il n’y avait pas que des anges. D’autres apparitions hantaient ces pénombres. Elles étaient souvent redoutables. Des géants avec des yeux et des barbes terribles. Ils avaient des chapeaux compliqués, des épées et des manteaux noirs. Ils marchaient de long en large, le regard fixe et ils murmuraient des incantations qui devaient être mortelles. Toutefois, en passant près de moi, ils me caressaient la tête, ce qui ne me rassurait guère.
J’ai même, une fois vu le diable en personne. Il était tout rouge et son bonnet s’ornait d’une immense plume. Ce qui m’a déconcerté, c’est qu’il mangeait une orange et qu’il m’en a donné un quartier… Est-ce depuis ce jour que les oranges me sont en même temps tentation et répulsion?
Le comble de ma terreur a été lorsque je me suis retrouvé au beau milieu d’une basse-cour gigantesque. Le coq, monstrueux dragon, tournait autour de moi en sautillant et en battant des ailes. C’était bien sûr dans l’intention de me faire rire, mais moi j’étais sûr qu’il allait me manger et j’ai hurlé de peur. Et voilà qu’une grosse poule est venue vers moi et, par une opération magique, a enlevé sa tête et ma mère m’est apparue souriante et rassurante. J’ai su plus tard que j’assistais aux répétitions de «Chantecler» d’Edmond Rostand.
Ces métamorphoses et ces gloires étaient d’ailleurs pour moi la réalité, le vrai monde, bien plus vrai et plus amusant que les tristes jours d’hiver et les pauvres maisons sans grâce dans lesquelles je vivais avec ma mère et sa famille. Comme j’ai détesté tout cela et comme j’étais déjà, et encore maintenant, plus à l’aise avec Ovide ou Molière qu’avec la «Guerre des Gaules» ou Lénine.
Si je parle de Lénine, ce n’est pas par hasard, c’est parce que la maison ou j’ai passé mon enfance était celle où il a vécu, à la rue des Plantaporrêts à Genève. Le fait qu’une des extrémités de cette rue aboutisse au Rhône, fleuve de délice, était bien plus passionnant en soi que cette référence historique.
Ma famille a été pour moi comme un nid douillet, plein d’affection, de rires et de chansons. L’absence d’un père était largement compensée par la présence d’un grand-père alsacien qui m’apprenait l’alphabet en allemand sur un air de Mozart. Également par de nombreux oncles qui m’apportaient la sécurité d’une présence masculine. Et lorsque ma mère courait les pays avec sa troupe de saltimbanques, elle était relayée par de nombreuses tantes qui m’entouraient d’une affection joyeuse.
Mais l’âme de la famille c’était ma grand-mère dont les yeux doux et les tendres mains me font encore maintenant pleurer de bonheur. Elle avait surtout un tablier avec une grande poche, comme celle des jardiniers, dans l’ombre de laquelle je venais enfouir ma tête lorsque j’avais une terreur ou un chagrin. Là, je savais que rien ne pouvait m’arriver de fâcheux. C’était un paradis calme, débordant d’amour et de sécurité.
Un fait aussi qui s’est révélé décisif, c’est que mon grand-père était relieur, qu’il avait le culte du livre et des images. Il entassait les uns un peu partout et il collait et reliait les autres en de gros livres.
Hors du théâtre, les moments les plus délicieux de mon enfance se situent sous la table du salon, caché par un épais tapis qui descendait jusque à terre et qui préservait ma chère pénombre. Là, indéfiniment, je feuilletais les grands livres d’images de mon grand-père. Tout me fascinait, mais surtout une grosse dame, très nue et très blanche, assise au bord d’une fontaine dans un jardin plein d’ombres et de roses. Elle se lavait les pieds et deux vieillards se cachaient pour la regarder. A leur attitude j’étais sûr qu’ils lui voulaient du mal, mais comme je n’osais pas griffonner leur visage, j’y mettais mes deux mains pour ne plus les voir et pour empêcher qu’ils ne vissent ma chère baigneuse.
Beaucoup plus tard, à Vienne, j’ai vu «ma» baigneuse. Je la connaissais depuis toujours, mais je savais enfin qu’elle s’appelait Suzanne et qu’elle était peinte par Le Tintoret. Quelle merveille et comme de nouveau ce jardin ombreux me fascinait.
D’ailleurs, grâce à mon grand-père toute la peinture m’a toujours été familière. Et quand je dis toute, ce sont vraiment des grottes de Lascaux à Cézanne, en passant par Memling et … les petits chats dans des chapeaux.
Plus tard, d’autres moments bouleversants se situent sous un vieux piano romantique aux pieds torsadés. L’un de mes oncles adoré en tirait des musiques célestes qui me tombaient en cascade sur le cœur et m’inondaient de bonheur. Elles me traversaient de part en part, elles ébranlaient mes os et ne laissaient rien d’intact en moi. Pour ne pas hurler ou mourir d’extase, je mordais à m’en casser les dents les tiges de cuivre des pédales. J’ai encore dans la bouche le goût du métal corrodé par mes larmes. Je sais maintenant que cette musique était du Chopin.
Ceci se passait à Sézegnin, petit village au bout du canton de Genève où mon oncle Louis était maître d’école. La maison était très isolée et sinistre. Tous les escaliers craquaient, les portes grinçaient, les courants d’air et les souris y donnaient un bal perpétuel. Mais ce qu’il y avait surtout d’inquiétant la nuit, c’était au rez-de-chaussée les classe d’école noires, silencieuses, pleines des fantômes de la journée. Les objets les plus ordinaires devenaient redoutables et n’attendaient que le moment où on aurait le dos tourné pour s’animer et ricaner. Il faut dire que j’avais été fasciné par les Jérôme Bosch des livres de mon grand-père et que je lisais à ce moment-là les «Histoires extraordinaires» d’Edgar Poe d’où sortaient tant de merveilles et tant de spectres blafards.
Pour mettre le comble à la lourde atmosphère de la maison, ma tante ne pouvait pas ouvrir une fenêtre sans voir la tête de sa mère flottant dans la nuit, à une certaine distance, les cheveux au vent et arborant un air très méchant. Je crois même bien l’avoir vue cette tête, tant ma tante avait de persuasion pour m’en parler. Cette tante, qui s’appelle Germaine Épierre est d’ailleurs devenue une excellente comédienne et comme ma mère, a beaucoup travaillé au théâtre de la Comédie de Genève.
Elle aussi a été très importante dans ma vie en m’apprenant que rêver c’était bien mais qu’il fallait aussi marcher. Et avec elle et mon oncle Louis j’ai marché et pédalé sur toutes les routes et escaladé toutes les montagnes du Valais. Comme c’était beau et comme c’était bien d’avoir épuisé très vite ma modeste part de paradis purement terrestre.
Pourtant avant de descendre avec Dostoïevski et Baudelaire dans les troubles profondeurs de l’âme, une période de repos s’imposait. Pendant quelques années, je n’ai plus eu d’autres ambitions que de me fondre dans la grise banalité des jours ordinaires. J’avais des pantalons golf et des vestes couleur de cendre et mon âme était endormie dans le triste brouillard d’un mauvais printemps qui n’en finissait plus. Mes bonnes marraines m’avaient un peu oublié.
Finis les mystères et les triomphes du théâtre, finies les ivresses des hauts sommets, c’était maintenant le morne ennui de l’école. Et pour compléter mon aspect de parfait petit idiot, j’ai même essayé de faire du «fauteballe»…! Sans grand succès d’ailleurs car n’ayant jamais très bien compris de quoi il s’agissait, je me suis rapidement fait éjecter de l’équipe.
A ces brutalités, je préférais de beaucoup jouer au «ballon prisonnier» avec les filles de l’école. Ah, être visé par de beaux yeux noirs ou bleus, être prisonnier de doux bras blancs, être serré sur des rondeurs naissantes!... Je crois que mes belles amazones m’ont redonné goût à la vie. Pour elles, j’avais envie de chanter, de faire quelque chose de grand. Mais quoi? Je n’étais capable de rien, je ne pouvais leur offrir que mes rêves informes.
C’est alors que ma mère, reine des fées, a eu la bonne idée de m’inscrire aux Beaux-Arts. Et voilà la magie retrouvée au cours de quatre années de bonheur intense!
L’ivresse de voir, de lire, d’entendre, de discuter sans fin avec des personnes remarquables et qui ont amorcé en moi ma propre découverte. L’ivresse d’apprendre à fabriquer des filets, d’abord maladroits, puis de plus en plus subtils, dans lesquels mes rêves venaient se prendre comme des papillons. Ah! Mes beaux papillons bariolés dont j’avais la tête pleine, pouvoir enfin les montrer, faire voir leurs formes et leurs couleurs! Mais je dois avouer que c’étaient surtout des papillons de nuit que j’attrapais.
Car en même temps que je découvrais la beauté, je découvrais du même coup qu’elle était nostalgique et nocturne. Elle était comme le reflet de quelque paradis, dont je ne savais encore rien, mais que je devinais au plus profond du cœur des hommes.
Mes gloires de théâtre et mes ivresses de montagnes ensoleillées étaient loin derrière moi et je n’avais plus la naïveté de confondre hauteur et altitude, ni de prendre les fanfares pour de la musique. Je commençais à comprendre que les plus belles images de ce monde prises au premier degré ne pouvaient être que décevantes. C’est qu’Éric Satie et le «Bateau ivre» m’avaient emmené très loin et on ne revient jamais d’un tel voyage.
Et puis était venu le temps des premières amours et des premiers chagrins. Et aussi des premiers engagements philosophiques, voire politiques. Encore que la politique, comme le sport, m’aient toujours fait un peu honte, me laissant dans le cœur comme un mauvais goût de lucre, de fraude, de brutalité, de haine et de sang. C’est que, sans avoir jamais participé aux uns ni aux autres, j’avais vu des lendemains de match et de manifestation Quelle horreur! Le Moloch de la bêtise et de la vulgarité laisse derrière lui de bien vilaines déjections, sans compter les larmes sur les victimes de ses stupides jeux.
Mais les Beaux-Arts se terminaient et je me suis réveillé sur un trottoir luisant de pluie. C’était la guerre, il faisait froid. Et surtout, personne n’avait besoin de mes papillons. Alors la vraie vie a commencé, avec ses longues patiences, ses mornes obligations et ses éblouissements imprévus, avec ses vraies joies et ses vraies douleurs. Et surtout avec ses hasards, que la liberté transforme non pas en nécessité mais en consentement.
Jean Roll
Mies,10 juin 1985